Franz Mehring : « LE CAPITAL » et Rosa Luxemburg les deuxiéme et troisiéme livres
I. Les douleurs de l’enfantement.
Quand Marx déclina l'invitation d'assister au congrès de Genève parce qu'il jugeait plus important pour les travailleurs d'achever son oeuvre principale -il pensait n'avoir écrit jusque-là que des vétilles- que de participer à un congrès quelconque, il avait en vue la besogne entreprise depuis le 1er janvier 1866: mettre au net et rédiger le premier livre. Et, au début, l'affaire allait bon train, car «il avait naturellement plaisir à lécher l'enfant après tant de douleurs d'enfantement ».
Ces douleurs d'enfantement avaient duré à peu près deux fois autant d'années que la physiologie demande de mois pour la fabrication d'un enfant normal. Marx pouvait dire avec raison que jamais peut-être une oeuvre de cette nature n'avait été écrite dans des conditions plus difficites. 1l n'avait cessé de s'assigner des délais pour en finir, « en cinq semaines » comme en 1851, ou «en six semaines» commeen 1858, mais ces projets se heurtaient à sa propre critique impitoyable et à son incomparable scrupulosité, qui l'incitaient toujours à de nouvelles recherches et que ne pouvaient ébranler même les exhortations impatientes de son plus fidèle ami.
Fin 1865, son travail était achevé, mais ce n'était encore qu'un manuscrit géant qui, sous cette forme, ne pouvait être édité par personne que par lui, pas même par Engels. De janvier 1866 à mars 1867, Marx tira de cette masse énorme le premier livre du Capital dans son texte classique, comme un «tout artistique », ce qui constitue bien l'illustration la plus brillante de sa fabuleuse puissance de travail. Ces cinq trimestres furent, en effet, remplis par d'incessantes maladies qui mirent même ses jours en danger en février 1866, par une accumulation de dettes qui «lui cassaient la tète», enfin, et surtout, par les absorbants travaux préparatoires au congrès de Genève de l'Internationale.
En novembre 1866, le premier paquet du manuscrit parvenait à Otto Meissner, à Hambourg, éditeur démocratique, chez qui Engels avait déjà fait paraître son petit ouvrage sur la question militaire prussienne. A la mi-avril 1867, Marx apporta lui-même le reste du manuscrit à Hambourg et trouva en Meissner un «gentil garçon» avec qui tout s'arrangea après de courtes négociations. En attendant les premières épreuves de l'impression qui s'effectuait à Leipzig, Marx rendit visite à son ami Kugelmann, à Hanovre, dont l'agréable famille, lui réserva l'accueil le plus hospitalier. Il passa là des semaines heureuses qu'il compta lui-même parmi «les plus belles et les plus riantes oasis dans le désert de l'existence». Une circonstance contribua aussi quelque peu à son humeur joyeuse, et une circonstance à laquelle il n'était nullement habitué: les milieux cultivés de Hanovre le reçurent avec considération et sympathie; et, le 24 avril, il écrivait à Engels:
C'est que nous avons tous deux auprès de la bourgeoisie « cultivée » une position toute différente de ce que nous savons.
Et Engels répondait le 27 avril:
107 Extrait de FRANZ Mehring, Karl Marx. Histoire de sa vie, Leipzig 1920 (3e édition). 65
Je me suis toujours imaginé que ce satané livre, que tu as couvé si longtemps, était la cause première de ta poisse et que tu ne sortirais de cette poisse que le jour où tu en serais délivré. Ce travail éternellement inachevé t'écrasait physiquement, intellectuellement et financièrement et je comprends fort bien qu'une fois débarrassé de ce cauchemar, tu te croies maintenant devenu un autre homme, d'autant plus que le monde, dès que tu vas y entrer, ne te paraîtra pas si morose que par le passé108.
Engels y attachait l'espoir d'être bientôt débarrassé de ce «commerce de chien». Tant qu'il y était plongé il n'était bon à rien; la chose avait surtout empiré depuis qu'il était principal, à cause des responsabilités accrues.
Marx lui répondit à ce sujet le 7 mai:
J'espère, et j'ai la ferme conviction, que dans une année je serai suffisamment riche pour pouvoir réformer de fond en comble ma situation économique et voler de nouveau de mes propres ailes. Sans toi, je n'aurais jamais pu mener mon oeuvre à bonne fin et, je te l'assure, j'ai toujours eu comme un poids sur la conscience à constater que c'était principalement à cause de moi que tu laissais gaspiller dans le commerce et rouiller ta force merveilleuse et que, par-dessus le marché, il te fallait encore prendre ta part de mes petites misères109.
En vérité, ni dans les années qui suivirent ni même d'une façon générale Marx n'est devenu «riche» et Engels dut rester encore quelques années dans le «commerce de chien»; néanmoins, l'horizon commençait à s'éclaircir.
Marx devait depuis longtemps une lettre à un adepte, l'ingénieur des mines Siegfried Meyer, qui avait vécu jusque-là à Berlin et qui, vers cette époque, émigra aux Etats-Unis; durant ces journées de Hanovre; Marx paya sa dette avec des paroles qui mettent une fois de plus en lumière son «insensibilité». Il écrivait :
Vous devez avoir très mauvaise opinion de moi, d'autant plus mauvaise si je vous dis que vos lettres ne m'ont pas seulement procuré une grande joie, mais m'ont été une véritable consolation durant la douloureuse période où je les reçus. Savoir assurer à notre parti un homme de valeur, à la hauteur des principes, me dédommage du pire. En outre, vos lettres étaient remplies de la plus agréable amitié pour moi personnellement et vous concevez que, en lutte acharnée avec le monde (officiel), je puis sous-estimer cela moins que tout. Pourquoi donc alors ne vous ai-je pas répondu ? Parce que je ne cessais de flotter au seuil de la tombe. Je devais, par conséquent, mettre à profit le moindre moment où j'étais capable de travailler pour achever mon oeuvre, à laquelle j'ai sacrifié la santé, le bonheur de vivre et la famille J'espère que cette explication se suffit. Je me ris des hommes dits pratiques et de leur sagesse. Si l'on voulait être un boeuf on pourrait, naturellement, tourner le dos aux douleurs de l'humanité et s'occuper de sa propre personne. Mais je me serais vraiment tenu pour impratique110 si j'étais mort sans avoir entièrement achevé mon oeuvre, au moins en manuscrit.
Dans l'humeur joyeuse de ces journées, Marx a également pris au sérieux un certain Warnebold, avocat absolument inconnu de lui, qui lui transmettait le prétendu désir de Bismarck : Celui de l'utiliser, lui et ses grands talents, dans l'intérêt du peuple allemand. Non pas que Marx eût été enchanté de cette tentative de l'appâter ; il se sera dit, en effet, comme Engels : « La façon de penser et l'horizon du bonhomme sont caractérisés par le fait qu'il juge tout le monde d'après lui-même» . Mais, revenu au terre à terre de tous les jours, Marx aura difficilement cru au message de Warnebold. Dans l'état encore inachevé de la Contédération de l'Alllemagne du Nord, quand le danger d'une guerre avec la France au sujet du commerce luxembourgeois venait à peine d'être conjuré, il était impossible que Bismarck songeât à heurter de front la bourgeoisie - elle venait tout juste d'entrer dans son camp et regardait déjà d'un fort mauvais oeil ses lieutenants Bucher et Wagener - en prenant à son service l'auteur du Manifeste communiste.
Ce n'est pas avec Bismarck, mais avec une de ses parentes qu'à son retour à Londres
108 Correspondance Marx-Engels, t. IX, p. 153. (Edit. Costes.)
109 Idem p. 159
110 Dans le sens d'inutile. (N. T.) 66
Marx eut une petite aventure. Il la raconta, non sans une certaine gêne, à Kugelmann. Sur le paquebot, une jeune Allemande, qui l'avait déjà frappé par son maintien tout militaire, lui demanda des renseignements sur les gares londoniennes; d'où il résulta qu'elle devait attendre son train pendant quelques heures; ces quelques heures, Marx, en bon cavalier, l'aida à les passer en lui faisant faire une promenade à Hyde-Park.
C'est alors que j'appris qu'elle s'appelait Elisabeth de Puttkamer et qu'elle était la nièce de Bismarck, chez qui elle venait de passer quelques semaines à Berlin. Elle avait sur elle tout l'annuaire militaire, cette famille fournissant abondamment notre «vaillante armée» d'hommes d'honneur et de belle taille. C'était une jeune fille instruite et gaie, mais aristocrate et « noir-blanc » jusqu'au bout des ongles. Elle ne fut pas peu étonnée quand elle apprit qu'elle était tombée dans les mains d'un «rouge»111.
Mais la petite dame n'en perdit pas pour cela sa bonne humeur. Dans une lettre gentillette, elle exprimait à son cavalier avec un respect « enfantin » les «remerciements les plus cordiaux» pour la peine qu'il s'était donnée avec elle, «créature sans expérience»; ses parents faisaient également savoir leur plaisir d'apprendre qu'il y a encore des gens aimables en voyage.
A Londres, Marx termina la correction de son livre. Cette fois encore, il ne manqua pas de pester contre la lenteur de l'impression. Mais le 16 août 1867, à deux heures du matin, il pouvait tout de même annoncer à Engels qu'il venait d'achever la correction de la dernière feuille (la 49e).
Ce volume est donc fini. C'est à toi seulement. que je dois d'avoir pu le faire! Sans ton dévouement pour moi, il ne m'eût pas été possible de faire les travaux énormes nécessités par les trois volumes. Je t'embrasse le coeur rempli de gratitude... Salut mon cher, mon très cher ami112
II. le premier livre.
Dans le premier chapitre de son ouvrage, Marx résuma une fois de plus ce qu'il avait exposé dans son livre de 1859 sur la marchandise et l'argent. Il le fit non seulement par souci d'être complet, mais aussi parce que la chose n'avait pas été tout à fait bien comprise, même par des personne intelligentes, preuve que quelque chose devait clocher dans l'exposition, plus spécialement l'analyse de la marchandise.
Au nombre de ces personnes intelligentes ne comptaient certes pas les savants allemands qui avaient jeté l'anathème justement sur le premier chapitre du Capital, en raison de son « obscure mystique ».
Une marchandise parait au premier coup d'oeil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage il n'y a en elle rien de mystérieux. La forme du bois, par exemple, est changée si l'on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous les sens. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. A la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol; elle se dresse pour ainsi dire sur sa tète de bois en face des autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser113.
Cela, les têtes de bois le prirent mal, qui produisent en quantité industrielle subtilités métaphysiques et arguties théologiques, mais qui sont incapables de créer quoi que ce soit d'aussi concret qu'une ordinaire table de bois.
111 Lettres â Kugelmann p. 66. Editions sociales internationales, Paris.
112 Correspondance Marx-Engels, t. IX, p. 189-190.
113 Capital, t. i, p. 83/84, E. S. 1948.67
En fait, sous l'angle purement littéraire, le premier chapitre compte parmi ce que Marx a écrit de plus important. Il passa ensuite à l'analyse de la façon dont l'argent se transforme en capital. Si, dans la circulation des marchandises, des valeurs identiques s'échangent les unes contre les autres, comment le possesseur d'argent peut-il acheter des marchandises à leur valeur, les vendre à leur valeur et tirer néanmoins de la transac-tion plus de valeur qu'il n'y en a jeté? Il le peut uniquement parce que, dans les conditions sociales actuelles, il trouve sur le marché une marchandise d'une nature tellement singulière, dont la consommation est source de nouvelle valeur. Cette marchandise est la force de travail.
.
Elle existe dans la personne de l'ouvrier vivant qui a besoin d'une somme déterminée de moyens de subsistance pour son propre entretien et celui de sa famille, laquelle assure la continuation de la main d'oeuvre même après sa mort. Le temps de travail nécessaire pour fournir ces moyens de subsistance représente la valeur de la force de travail. Mais cette valeur payée en salaire est inférieure à la valeur que l'acquéreur de la main-d'oeuvre parvient à tirer de cette dernière. Le travail accompli par l'ouvrier en sus du temps nécessaire pour le remplacement de son salaire constitue la source de la plus-value, de l'augmentation continue du capital. Le travail non payé de l'ouvrier entretient tous les membres non travailleurs de la société; c'est sur lui que repose tout l'édifice social où nous vivons.
Il est vrai que le travail non payé n'est pas en lui-même une particularité de la société bourgeoise moderne. Depuis qu'il existe des classes possédantes et non possédantes, la classe non possédante a toujours dû fournir du travail non payé. Tant qu'une partie de la société détient le monopole des moyens de production, l'ouvrier doit, de gré ou contre son gré, ajouter au temps de travail nécessaire pour son entretien un temps de travail en excédent, afin de produire les moyens de subsistance destinés aux détenteurs des moyens de production. Le travail salarié n'est qu'une forme historique particulière du système du travail non payé qui règne depuis la séparation des classes, une forme histo-rique particulière qui doit être étudiée comme telle pour être justement comprise.
Pour la transformation de l'argent en capital, le possesseur d'argent doit trouver sur le marché l'ouvrier libre, libre en ce double sens qui il dispose comme personne libre de sa force de travail en tant que marchandise lui appartenant, et qu'il n'a pas d'autre marchandise à vendre; donc qu'il est séparé de tous les objets nécessaires à la réalisation de sa force de travail. Ce n'est pas là un rapport historique naturel, car la nature ne produit pas d'un côté des possesseurs d'argent et de marchandiseset de l'autre des êtres possédant seulement leur force de travail. Mais ce n'est pas non plus un rapport social commun à toutes les périodes de l'histoire; c'est le résultat d'un long développement historique, le produit de nombreuses transformations économiques, de toute une série de vieilles formations disparues de la production sociale.
La production des marchandises est le point de départ du capital. La production des marchandises, la circulation des marchandises et leur circulation développée - le commerce forment les conditions historiques qui président à son apparition. De la création du commerce moderne et du marché mondial au XVIe siècle date l'histoire moderne du capital. L'illusion des économistes vulgaires voulant qu'il se soit trouvé à une certaine époque une élite travailleuse accumulant des richesses et une masse de gueux paresseux n'ayant rien eu à vendre au bout du compte que leur propre peau est une fade puérilité: une puérilité aussi fade que la pénombre dans laquelle les historiens bourgeois plongent la désagrégation du mode de production féodal, qu'ils présentent comme l'émancipation de l'ouvrier et non pas, du même coup, comme la transformation du mode de production féodal en mode de production capitaliste. En même temps que les ouvriers cessaient d'appartenir directement aux moyens de production, comme les esclaves et les serfs, les moyens de production cessaient de leur appartenir, comme chez le paysan et l'artisan travaillant à leur compte. Par une série de méthodes violentes et cruelles, que Marx décrit en détail dans son chapitre sur l'accumulation primitive, en se fondant sur l'histoire anglaise, la grande masse de la population fut dépouillée de la terre, des
68
moyens de subsistance et des instruments de travail. Ainsi prirent naissance les ouvriers libres dont le mode de production capitaliste avait besoin; le capital est venu au monde dégouttant de sang et de boue par tous ses pores, de la tête aux pieds. A peine dressé sur ses propres jambes. non seulement il maintint, mais encore il reproduisit à une échelle sans cesse croissante la séparation entre le travailleur et la propriété des conditions qui permettent la réalisation du travail.
Le salariat se distingue des formes antérieures de travail non payé par le fait que le mouvement du capital est démesuré, que son appétit de surtravail est insatiable. Dans les formations sociales-économiques où la valeur d'usage prédomine dans le produit, et non sa valeur d'échange, le surtravail est limité par un cercle plus ou moins large de besoins, mais la nature de la production ne donne pas lieu à un besoin illimité de surtravail. Il en va autrement quand prédomine la valeur d'échange. Producteur du labeur d'autrui, soutireur de surtravail et exploiteur de la main-d'oeuvre, le capital surpasse de loin en énergie, en étendue et en efficacité tous les processus de production antérieurs, basés sur le travail forcé direct. Il ne s'agit pas pour lui du processus de travail, de la production de valeurs d'usage, mais du processus de mise en valeur, de la production de valeurs d'échange, dont il pourra tirer plus de valeur, qu'il n'y en a investi. L'appétit de plus-value ignore la satiété ; la production de valeurs d'échange ne connaît pas les limites que la satisfaction des besoins assigne à la production de valeurs d'usage.
De même que la marchandise est unité114 de valeur d'usage et de valeur d'échange, de même, le processus de production de la marchandise est unité de processus de travail et de processus générateur de valeur. Le processus générateur de valeur dure jusqu'au moment où la valeur de la main-d'oeuvre payée en salaire est remplacée par une valeur égale. A partir de ce point, il devient processus de production de plus-value, processus de mise en valeur. Unité de processus de travail et de processus de mise en valeur, il devient processus de production capitaliste, forme capitaliste de la production des marchandises. Dans le processus de travail, l'ouvrier et le moyen de production coo-pèrent ; dans le processus de mise en valeur, les mêmes parties constituantes du capital apparaissent comme capital constant et capital variable. Le capital constant se convertit en moyens de production matériel brut, produits accessoires, instruments de travail, et ne change pas de valeur dans le processus de production. Le capital variable se convertit en force de travail et change de valeur dans le processus de production : il reproduit sa propre valeur plus un excédent, la plusvalue, qui peut elle-même varier, être plus grande ou plus petite. De la sorte, Marx se trace une voie parfaitement claire pour l'étude de la plus-value dont il trouve deux formes, la plus-value absolue et la plus-value relative, qui ont joué des rôles différents, mais l'un et l'autre décisifs, dans l'histoire du mode de production capitaliste.
De la plus-value absolue est produite, quand le capitaliste prolonge le temps de travail au delà du temps nécessaire pour la reproduction de la force de travail. Si tout allait selon ses désirs, la journée de travail aurait vingt-quatre heures, car plus est longue la journée de travail et plus est grande la plus-value produite. Inversement, l'ouvrier a le juste sentiment que chaque heure de travail fournie en sus de l'équivalent du salaire lui est soutirée injustement. Son propre corps est là pour montrer ce que signifie travailler trop longtemps. La lutte pour la longueur de la journée de travail n'a pas cessé depuis la première apparition historique d'ouvriers libres jusqu'à maintenant.
Le capitaliste lutte pour son profit et la concurrence l'oblige - fût-il personnellement un homme probe ou un coquin - à prolonger la journée de travail jusqu''aux extrêmes limites des possibilités humaines. L'ouvrier lutte pour sa santé, pour quelques heures de repos quotidien, afin de pouvoir exercer une activité humaine en dehors du «travailler, manger et dormir». Marx décrit de la façon la plus impressionnante le demi-siècle de guerre civile menée en Angleterre par la classe capitaliste et la classe ouvrière; cette guerre civile commença avec la naissance de la grande industrie, qui incita les capitalistes à renverser toutes les limites que la nature et les coutumes, l'âge et le sexe,
114 Est à la fois valeur d'usage et valeur d'échange. (N. T.) 69
le jour et la nuit, traçaient à l'exploitation du prolétariat elle durera jusqu'à la pro-mulgation du bill des dix heures, conquis par la classe ouvrière comme un puissant obstacle social qui l'empêche de se livrer elle-même et son espèce par un contrat volontaire, à la discrétion absolue du capital.
De la plus-value relative est produite quand le temps de travail nécessaire pour la reproduction de la force de travail est réduit au bénéfice du surtravail. La valeur de la force de travail est réduite quand la force productive du travail est accrue dans les branches d'industrie dont les produits déterminent la valeur de la force de travail. Pour cela, il faut un bouleversement continu du mode de production, des conditions techniques et sociales du processus de travail. Les explications historiques économiques, technologiques et psycho-sociales développées à ce sujet par Marx dans une série de chapitres traitant de la coopération, de la division du travail et de la manufacture, du machinisme et de la grande industrie, ont été reconnues même par les bourgeois. comme des sources fécondes de découverte scientifique.
Marx ne montre pas seulement que le machinisme et la grande industrie ont engendré une misère effroyable, comme aucun mode de production ne l'avait fait avant eux; il montre aussi que, dans son «révolutionnement» ininterrompu, la société capitaliste prépare une forme sociale plus élevée. La législation des fabriques est la première réac-tion consciente et systématique de la société sur la structure antinaturelle de son processus de production. En réglementant le travail dans les fabriques et la manufacture, cette législation n'apparaît tout d'abord que comme une ingérance dans les droits d'exploitation du capital.
Mais la rigueur des faits oblige bientôt à réglementer aussi le travail à domicile et à intervenir dans l'autorité paternelle, c'est-à-dire à reconnaître qu'avec la base éconcmique de l'antique famille et du travail à domicile qui lui correspond, la grande industrie disloque elle-même les vieilles conditions de la famille.
Si terrible et si dégoûtante que paraisse dans le milieu actuel la dissolution des anciens liens de famille, la grande industrie, grâce au rôle décisif qu'elle assigne aux femmes et aux enfants, en dehors du cercle domestique, dans des procès de production socialement organisés, n'en crée pas moins la nouvelle base économique sur laquelle s'élévera une forme supérieure de la famille et des relations entre les sexes. Il est aussi absurde de considérer comme absolu et définitif le mode germano-chrétien de la famille que des modes oriental, grec et romain, lesquels forment d'ailleurs entre eux une série, progressive. Même la composition du travailleur collectif par individus de deux sexes et de tout âge, cette source de corruption et d'esclavage sous le règne capitaliste, porte en soi les germes d'une nouvelle évolution sociale115.
La machine, qui dégrade l'ouvrier pour n'en faire que son appendice, crée en même temps la possibilité de porter les forces productives de la société à un niveau élevé qui permettra un développement humain pour tous les membres de la société, ce pourquoi toutes les formes sociales antérieures étaient trop pauvres.
Après avoir étudié la production de la plus-value absolue et relative, Marx développe la première théorie rationnelle du salaire que connaisse l'histoire de l'économie politique. Le prix d'une marchandise est sa valeur exprimée en argent et le salaire est le prix de la force de travail. Ce n'est pas le travail qui apparaît sur le marché, mais l'ouvrier qui offre sa force de travail, et le travail ne prend naissance qu'avec la consommation de la marchandise «main-d'oeuvre». Le travail est la substance et la mesure immanente des valeurs, mais lui-même n'a pas de valeur. Cependant, le salaire semble payer le travail parce que l'ouvrier ne le reçoit qu'une fois le travail accompli. La forme du salaire efface toute trace de division de la journée de travail en travail payé et travail non payé. C'est l'inverse de ce qui se passe avec l'esclavage. L'esclave semblait ne travailler que pour son maître, même dans la partie de la journée de travail où il ne faisait que remplacer la valeur de ses propres moyens de subsistance; tout son travail apparaît comme du travail
115 1,. Capital, t. II. p. 168. E. S. 198.70
non payé. Dans le salariat, au contraire, le travail non payé lui-même apparaît comme payé. Dans un cas, le rapport de propriété dissimule le travail effectué pour son propre compte par l'esclave; dans l'autre, le rapport d'argent dissimule le travail gratuit de l'ouvrier salarié.
On conçoit, par, conséquent, écrit Marx, l'importance décisive de la transformation de la valeur et du prix de la force de travail en salaire ou en valeur et prix du travail lui-même. Sur cette forme apparente, qui rend invisible le rapport réel et fait apparaître exactement son contraire, repose toute la notion juridique de l'ouvrier comme du capitaliste, toute la mystification du mode de production capitaliste, toutes ses illusions de liberté, toutes les billevesées apologétiques de l'économie vulgaire.
Les deux formes fondamentales du salaire sont le salaire horaire et le salaire aux pièces. A la lumière des lois du salaire horaire, Marx démontre le vide intéressé des phrases prétendant qu'une limitation de la journée de travail doit faire baisser le salaire C'est exactement le contraire qui est vrai. Une diminution passagère de la journée de travail réduit le salaire, mais une diminution durable l'élève; plus est longue la journée de travail, plus le salaire est bas.
Le salaire aux pièces n'est pas autre chose qu'une forme modifiée du salaire au temps; c'est la forme du salaire qui correspond le mieux au mode de production capitaliste. Il prit une grande extension durant la période manufacturière proprement dite; dans la phase du développement tumultueux de la grande industrie anglaise, il fut un moyen d'allonger le temps de travail et de réduire les salaires. Le salaire aux pièces est très avantageux pour le capitaliste, parce qu'il rend en grande partie superflue la surveillance du travail et qu'il offre, par-dessus le marché, les occasions les plus diverses d'amputer le salaire et d'accomplir d'innombrables autres escroqueries. Pour les ouvriers, il entraîne en revanche de grands désavantages : éreintement par le surtravail qui doit augmenter le salaire, alors qu'il tend, en fait, à le réduire, concurrence accrue entre les ouvriers et affaiblissement de leur conscience solidaire, apparition de parasites qui s'interposent entre les capitalistes et les ouvriers, d'intermédiaires qui détachent du salaire payé un fragment considérable, et ainsi de suite.
Le rapport entre plus-value et salaire fait que le mode de production capitaliste non seulement reproduit sans cesse le capital, mais encore engendre en permanence le paupérisme des ouvriers: d'un côté les capitalistes qui sont les propriétaires de tous les moyens de subsistance, de toutes les matières premières et de tous les instruments de travail, et de l'autre la grande masse des ouvriers qui sont obligés de vendre leur force de travail à ces capitalistes pour une quantité de moyens de subsistance tout juste suffisante dans le meilleur des cas à les maintenir en état de travailler et à élever une nouvelle génération de prolétaires capables de travailler. Mais le capital ne fait pas que se reproduire, il s'accroît et se multiplie sans répit ; et Marx consacre le dernier chapitre du premier livre à ce «processus d'accumulation».
La plus-value découle du capital, mais le capital découle aussi de la plus-value. Une partie de la plus-value produite annuellement est consommée en tant que revenu par les classes possédantes, parmi lesquelles elle se répartit, cependant qu'une autre partie est accumulée sous forme de capital. Le travail non payé soutiré à la classe ouvrière est maintenant un moyen de lui soustraire de plus en plus de travail non payé. D'une façon générale , d'ailleurs, le capital primitivement avancé devient, au cours de la production, une grandeur de plus en plus infime quand on le compare au capital directement accumulé, c'est-à-dire à la plus-value ou au surproduit qui revient au capital, soit dans la main qui a accumulé, soit dans une main étrangère. La loi de la propriété privée reposant sur la production et la circulation des marchandises se mue en son contraire direct par le jeu de sa propre dialectique interne et inéluctable. Les lois de la production des marchandises semblent fonder le droit de propriété du travailleur sur son propre travail. Des possesseurs égaux de marchandises étaient face à face ; pour chacun d'eux, le moyen d'appropriation de la marchandise de l'autre n'était que l'aliénation de sa propre marchandise et cette marchandise ne pouvait être produite que par le travail. Maintenant, la propriété apparaît, du côté du capitaliste, comme le droit de s'emparer du travail d'autrui non payé ou du produit de ce travail, du côté de l'ouvrier comme
71
l'impossibilité de s'approprier le produit fabriqué par
lui-même.
Lorsque les prolétaires modernes eurent commencé à discerner ce rapport, lorsque le prolétariat urbain de Lyon eut fait sonner le tocsin, que le prolétariat agricole d'Angleterre lâcha le coq rouge, les économistes vulgaires inventèrent la «théorie de l'abstinence» d'après laquelle le capital prend naissance grâce à l' «abstinence volontaire» de la classe capitaliste, théorie que Marx fouaille tout aussi impitoyablement que Lassalle l'avait fouaillée avant lui.
Mais ce qui contribue réellement à l'accumulation du capital, c'est l' «abstinence » imposée aux ouvriers, l'abaissement forcé du salaire au-dessous de la valeur de la force de travail, ayant pour but de transformer partiellement en fonds d'accumutation du capital le fonds de consommation nécessaire des ouvriers. Nous trouvons là l'origine réelle des jérémiades sur la vie «luxueuse» des ouvriers, les litanies interminables sur la bouteille de champagne que des maçons auraient un jour vidée pour leur petit déjeuner, les recettes de cuisine à bon marché des réformateurs sociaux chrétiens et tout ce qui appartient à ce domaine de la mesquinerie capitaliste.
Voici donc ce qu'est, en fait, la loi générale de l'accumulation capitaliste. La croissance du capital implique la croissance de sa partie variable ou partie transformée en force de travail. Si la composition du capital reste invariable, si une quantité déterminée de moyens de production a toujours besoin de la même masse de force de travail pour être mise en mouvement, la demande de main-d'oeuvre et le fonds de subsistance des ouvriers grandissent en relation directe avec le capital, d'autant plus vite que le capital grandit plus vite. De même que la reproduction simple reproduit continuellement le même rapport capitaliste, de même, l'accumulation reproduit le rapport capitaliste à un niveau supérieur : augmentation du nombre des capitalistes ou de leur importance à un pôle, augmentatiom du nombre des ouvriers salariés à l'autre. L'accumulation du capital est donc la multiplication du prolétariat, et, dans le cas envisagé, elle a lieu dans les conditions les plus favorables pour les ouvriers. Une partie plus grande de leur propre surproduit - qui augmente et se mue en nouveau capital - leur revient sous forme de moyens de paiement, en sorte qu'ils peuvent élargir le cercle de leurs besoins et accroître leur fonds de consommation, de vêtements, de meubles, etc. Toutefois, le rapport de dépendance où ils se trouvent n'en est pas modifié, pas plus qu'un esclave bien vêtu et bien nourri cesse pour cela d'être un esclave. Ils doivent continuer de fournir une certaine quantité de travail non payé, qui peut diminuer il est vrai, mais jamais jusqu'au point où le caractère capitaliste du processus de production pourrait être sérieusement menacé. Si les salaires s'élèvent au-dessus de ce niveau, la pointe du bénéfice s'émousse et l'accumulation du capital se ralentit jusqu'au moment où les salaires retombent à un niveau correspondant à ses besoins de mise en valeur.
Toutefois, c'est seulement lorsque le rapport entre les parties constante et variable ne change pas dans l'accumulation du capital que la chaîne d'or, que le salarié se forge à lui-même, se relâche. Mais, en fait, les progrès de l'accumulation entraînent une grande révolution dans ce que Marx appelle la composition organique du capital. Le capital constant grandit aux dépens du capital variable; la productivité croissante du travail a pour conséquence que la masse des moyens de production grandit plus vite que la masse de force de travail qui y est incorporée; la demande de main-d'oeuvre n'augmente pas au même rythme que l'accumulation du capital, au contraire, elle diminue en valeur rela-tive. Sous une autre forme, le même effet est réalisé par la concentration du capital qui s'accomplit indépendamment de son accumulation, du fait que les lois de la concurrence capitaliste aboutissent à l'absorption du petit capital par le gros. Tandis que le capital supplémentaire engendré au cours de l'accumulation attire de moins en moins d'ouvriers par rapport à sa grandeur, le vieux capital reproduit avec une nouvelle composition évince de plus en plus les ouvriers qu'il employait précédemment. Ainsi, prend naissance une population ouvrière relativement superflue, c'est-à-dire superflue pour les besoins d'exploitation du capital, une armée industrielle de réserve; en périodes d'affaires mauvaises ou moyennes, cette armée est irrégulièrement occupée et payée au-dessous de la valeur de sa force de travail, ou bien encore livrée à la bienfaisance publique; dans tous les cas, elle sert à paralyser la résistance des ouvriers occupés et à maintenir leurs salaires à un niveau inférieur.
Produit nécessaire de l'accumulation ou du développement de la richesse sur une base capitaliste, l'armée industrielle de réserve devient inversement le levier du mode de production capitaliste. Avec l'accumulation et le développement de la force productive du travail qui l'accompagne, grandit la force d'expansion soudaine du capital, qui a besoin de grandes masses humaines pour pouvoir les jeter brusquement, et sans pour chacun d'eux, le moyen d'appropriation de la marchandise de l'autre n'était que l'aliénation de sa propre marchandise et cette marchandise ne pouvait être produite que par le travail Maintenant, la propriété apparaît, du côté du capitaliste, comme le droit de s'emparer du travail d'autrui non payé ou du produit de ce travail, du côté de l'ouvrier comme l'impossibilité de s'approprier le produit fabriqué par lui-même.
Lorsque les prolétaires modernes eurent commencé à discerner ce rapport, lorsque le prolétariat urbain de Lyon eut fait sonner le tocsin, que le prolétariat agricole d'Angleterre lâcha le coq rouge, les économistes vulgaires inventèrent la «théorie de l'abstinence» d'après laquelle le capital prend naissance grâce à l' «abstinence volontaire» de là classe capitaliste, théorie que Marx fouaille tout aussi impitoyablement que Lassalle l'avait fouaillée avant lui. Mais ce qui contribue réellement à l'accumulation du capital, c'est l' «abstinence » imposée aux ouvriers, l'abaissement forcé du salaire au-dessous de la valeur de la force de travail, ayant pour but de transformer partiellement en fonds d'accumulation du capital le fonds de consommation nécessaire des ouvriers. Nous trouvons là l'origine réelle des jérémiades sur la vie «luxueuse» des ouvriers, les litanies interminables sur la bouteille de champagne que des maçons auraient un jour vidée pour leur petit déjeuner, les recettes de cuisine à bon marché des réformateurs sociaux chrétiens et tout ce qui appartient à ce domaine de la mesquinerie capitaliste.
Voici donc ce qu'est, en fait, la loi générale de l'accumulation capitaliste. La croissance du capital implique la croissance de sa partie variable ou partie transformée en force de travail. Si la composition du capital reste invariable, si une quantité déterminée de moyens de production a toujours besoin de la même masse de force de travail pour être mise en mouvement, la demande de main-d'oeuvre et le fonds de subsistance des ouvriers grandissent en relation directe avec le capital, d'autant plus vite que le capital grandit plus vite. De même que la reproduction simple reproduit continuellement le même rapport capitaliste, de même, l'accumulation reproduit le rapport capitaliste à un niveau supérieur : augmentation du nombre des capitalistes ou de leur importance à un pôle, augmentation du nombre des ouvriers salariés à l'autre. L'accumulation du capital est donc la multiplication du prolétariat, et, dans le cas envisagé, elle a lieu dans les conditions les plus favorables pour les ouvriers. Une partie plus grande de leur propre surproduit - qui augmente et se mue en nouveau capital - leur revient sous forme de moyens de paiement, en sorte qu'ils peuvent élargir le cercle de leurs besoins et accroître leur fonds de consommation, de vêtements, de meubles, etc. Toutefois, le rapport de dépendance où ils se trouvent n'en est pas modifié, pas plus qu'un esclave bien vêtu et bien nourri cesse pour cela d'être un esclave. Ils doivent continuer de fournir une certaine quantité de travail non payé, qui peut diminuer il est vrai, mais jamais jusqu'au point où le caractère, capitaliste du processus de production pourrait être sérieusement menacé. Si les salaires s'élèvent au-dessus de ce niveau, la pointe du bénéfice s'émousse et l'accumulation du capital se ralentit jusqu'au moment où les salaires retombent à un niveau correspondant à ses besoins de mise en valeur.
Toutefois, c'est seulement lorsque le rapport entre les parties constante et variable ne change pas dans l'accumulation du capital que la chaîne d'or, que le salarié se forge à lui-même, se relâche. Mais, en fait, les progrès de l'accumulation entraînent une grande révolution dans ce que Marx appelle la composition organique du capital.
Le capital constant grandit aux dépens du capital variable; la productivité croissante du travail a pour conséquence que la masse des moyens de production grandit plus vite que la masse de force de travail qui y est incorporée; la demande de main-d'oeuvre n'augmente pas au même rythme que l'accumulation du capital; au contraire, elle diminue en valeur relative. Sous une autre forme, le même effet est réalisé par la concentration du capital qui s'accomplit indépendamment de son accumulation, du fait que les lois de la concurrence capitaliste aboutissent à l'absorption du petit capital parle gros. Tandis que le capital supplémentaire engendré au cours de l'accumulation attire de moins en moins d'ouvriers par rapport à sa grandeur, le vieux capital reproduit avec une nouvelle composition évince de plus en plus les ouvriers qu'il employait précédemment. Ainsi, prend naissance une population ouvrière relativement superflue, c'est-à-dire superflue pour les besoins d'exploitation du capital, une armée industrielle de réserve; en périodes d'affaires mauvaises ou moyennes, cette armée est irrégulièrement occupée et payée au-dessous de, la valeur de sa force de travail, ou bien encore livrée à la bienfaisance publique; dans tous les cas, elle sert à paralyser la résistance des ouvriers occupés et à maintenir leurs salaires à un niveau inférieur.
Produit nécessaire de l'accumulation ou du développement de la richesse sur une base capitaliste, l'armée industrielle de réserve devient inversement le levier du mode de production capitaliste. Avec l'accumulation et le développement de la force productive du travail qui l'accompagne, grandit la force d'expansion soudaine du capital, qui a besoin de grandes masses humaines pour pouvoir les jeter brusquement, et sans interruption du cycle de la production, dans d'autres sphères, sur d'autres marchés ou dans de nouvelles branches de production. La marche caractéristique de l'industrie moderne, le cycle décennal, entrecoupé de petites oscillations, de périodes de vigueur moyenne, de pro-duction à toute vapeur, de crise et de stagnation, repose sur la formation continue, l'absorption plus ou moins grande et la reconstitution de l'armée industrielle de réserve.
Plus est grande la richesse sociale, le capital fonctionnant, l'ampleur et l'énergie de sa croissance, donc aussi la grandeur absolue de la population ouvrière et la force productive de son travail, plus est grande la surpopulation relative ou armée industrielle de réserve. Sa grandeur relative augmente avec la puissance de la richesse. Mais plus est grande l'armée industrielle de réserve par rapport à l'armée ouvrière active, et plus sont massives les couches ouvrières dont la misère est en raison inverse de leur peine au travail; Plus est grande enfin la couche de Lazares de la classe ouvrière et l'armée industrielle de réserve et plus est important le paupérisme officiel. Telle est la loi générale absolue de l'accumulation capitaliste.
De cette loi, découle également la tendance historique de cette accumulation. Parallèlement à l'accumulation et à la concentration du capital se développent de plus en plus la forme coopérative du travail, l'application technique délibérée de la science, l'exploitation commune systématique de la terre, la transformation des moyens de travail en machines utilisables seulement d'une manière collective, l'économie de tous les moyens de production grâce à leur utilisation en temps que moyens de production communs du travail social combiné. Tandis que diminue sans cesse le nombre des magnats capitalistes qui usurpent et monopolisent tous les avantages de cette transformation, on voit grandir la masse de la misère, de l'oppression, de la servitude, de la dégradation, de l'exploitation, mais aussi de l'indignation de la classe ouvrière, en augmentation continue, instruite, unie et organisée par le mécanisme même du processus de production capitaliste. Le capital monopolisateur devient une entrave au mode de production, qui se développe avec et sous lui. La concentration des moyens de production, et la socialisation du travail atteignent un degré où elles deviennent incompatibles avec leur enveloppe capitaliste; Le glas de la propriété capitaliste privée sonne, les expropriateurs sont expropriés.
La propriété individuelle, fondée sur le travail individuel, se rétablit, mais sur la base de la conquête de l'ère capitaliste: en tant que coopération d'ouvriers libres, en tant que propriété commune de la terre et des moyens de production fabriqués par le travail même. Il va sans dire que la transformation en propriété sociale de la propriété capitaliste reposant déjà sur là production socialisée est loin d'être aussi longue, pénible et difficile que fut la transformation en propriété capitaliste de la propriété morcelée reposant sur le travail des individus. Il s'agissait dans ce dernier cas de l'expropriation de la masse du peuple par quelques usurpateurs; il s'agira dans l'autre cas de l'expropriation de quelques usurpateurs par la masse du peuple.
Franz MEHRING
Rosa Luxembourg :
III. Les deuxième et troisième livres116
Avec les deuxième et troisième livres de son oeuvre, Marx eut le même sort qu'avec le premier; il espérait pouvoir les publier aussitôt après la parution de ce dernier, mais de longues années passèrent et il ne devait pas lui être donné d'achever ces deux livres pour les remettre à l'impression.
Des études toujours nouvelles et de plus en plus approfondies, de longues maladies, la mort enfin l'empêchèrent de terminer l'oeuvre entière; voilà pourquoi Engels rédigea les deux livres en se servant des manuscrits inachevés de son ami. C'étaient des brouillons, des esquisses, des notes, tantôt de grands chapitres cohérents. tantôt des remarques rapidement jetées sur le papier, comme un chercheur a coutume de faire pour son usage personnel - gigantesque travail intellectuel qui s'étend, avec de longues interruptions, de 1861 à 1878.
Ces circonstances expliquent que nous ne devons pas chercher dans les deux derniers livres du Capital une solution achevée de tous les grands problèmes de l'économie politique, mais seulement leur énoncé partiel, avec des indications sur la direction où il convient de chercher cette solution. Comme l'ensemble des conceptions de Marx, son oeuvre essentielle n'est pas une bible de vérités définitives, établies une fois pour toutes; c'est, au contraire, une source inépuisable d'incitations au travail intellectuel, à la recherche et à la lutte incessante pour la vérité.
Ces mêmes circonstances expliquent qu'au point de vue extérieur également, dans la forme littéraire, les deuxième et troisième, livres ne soient pas aussi achevés que le premier, n'étincellent pas d'esprit comme lui. Pourtant, et justement dans la simplicité de leur effort de pensée, étranger à tout souci de forme, ils offrent à plus d'un lecteur une jouissance encore plus élevée que le premier.
Bien qu'aucune popularisation n'en ait tenu compte, bien qu'ils soient, par conséquent ignorés de la grande masse des ouvriers éclairés, ces deux livres n'en constituent pas moins un complément et un développement essentiels du premier, indispensables à l'intelligence de tout le système.
Dans le premier livre, Marx étudie la question cardinale de l'économie politique : D'où provient l'enrichissement, où est la source du profit ? Avant que Marx entrât en lice, la réponse à ces questions était donnée dans deux directions différentes.
Les défenseurs « scientifiques» du meilleur des mondes, celui où nous vivons, des hommes dont certains, comme Scbulze-Delitzsch, jouissaient également de la considération et de la confiance des ouvriers, expliquaient la richesse capitaliste par toute une série de raisons plus ou moins plausibles et de manipulations habiles: résultat de l'adjonction systématique au prix des marchandises d'un supplément « dédommageant » le patron pour le capital noblement « abandonné par lui dans la production; indemnité pour le « risque » couru par chaque patron ; rémunération pour la « direction spirituelle» du patron, et ainsi de suite. Toutes ces explications visaient le même but: présenter comme « légitime » et immuable la richesse des uns, donc la pauvreté des autres.
En revanche, les critiques de la société bourgeoise, dont les écoles socialistes qui apparurent avant Marx, expliquaient pour la plupart l'enrichissement des capitalistes comme du pillage pur et simple, voire comme un vol pratiqué au détriment des ouvriers et rendu possible par l'interposition de l'argent ou par le manque d'organisation du pro-cessus de production. Partant de là, ces socialistes aboutirent à divers plans utopiques sui la façon de supprimer l'exploitation par la suppression de l'argent, par l' «organisation du travail » ,etc..
116 1. Dans sa préface de mars 1918:-Franz Mehring écrit : « Afin de donner, dans les limites étroites de mon exposé un tableau tout à fait clair des livres Il et 111 du Capital, j'ai demandé l'aide de mon amie Rosa Luxembourg. Les lecteurs la remercieront, autant que moi-même, d'avoir répondu si volontiers à mes désirs ; la troisième section du douzième chapitre a été écrite par elle. Je suis heureux d'incorporer à cet ouvrage ce joyau dû à sa plume.- ».(N. R.) 76
Or, dans le premier livre du Capital, Marx révèle la véritable origine de l'enrichissement capitaliste. Il ne s'occupe ni de justifier les capitalistes, ni d'accuser leur injustice : il montre pour la première fois comment apparaît le profit et comment il tombe dans les poches du capitaliste. Il explique le phénomène par deux faits gconomiques décisifs : en premier lieu, la masse des ouvriers se compose de prolétaires, obligés de vendre leur force de travail en tant que marchandise, en second lieu, cette marchandise qu'est la force de travail possède aujourd'hui un degré de productivité tellement élevé qu'elle peut
engendrer en un temps donné une quantité de produits beaucoup plus grande qu'il lui en faut à elle-même pour se maintenir pendant ce laps de temps. Ces deux faits purement économiques, qui découlent du développement historique objectif, ont pour conséquence que le fruit du travail du prolétaire tombe tout à fait naturellement en possession du capitaliste et s'accumule mécaniquement, pour constituer des quantités de plus en plus énormes de capitaux au fur et à mesure que se maintient le système du salariat.
Marx n'explique donc pas l'enrichissement capitaliste comme un quelconque dédommagement du capitaliste compensant des sacrifices et des bienfaits imaginaires ; il ne l'explique pas davantage comme de l'escroquerie ou du vol pur et simple au sens courant de ces mots ; il l'explique comme un échange absolument régulier au point de vue juridique entre le capitaliste et l'ouvrier, échange entièrement conforme aux lois qui régissent n'importe quel autre acte de vente et d'achat de marchandises.
Pour élucider à fond le mécanisme de cette affaire irréprochable, qui porte des fruits magnifiques pour le capitaliste, Marx dut développer jusqu'au bout, en l'appliquant à la marchandise force de travail, la loi de la valeur énoncée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles par les grands classiques anglais Smith et Ricardo, cest-à-dire l'explication des lois internes de l'échange des marchandises.
La loi de la valeur, dont dérivent le salaire et la plus-value, c'est-à-dire l'explication du processus par lequel, sans aucune escroquerie violente, le produit du travail salarié se partage de lui-même en moyens d'existence misérables pour l'ouvrier et en richesses obtenues sans travail pour le capitaliste tel est le contenu fondamental du premier livre du Capital. Et là réside également sa grande importance historique : il a montré que pour supprimer l'exploitation il faut avant tout, il faut exclusivement, que soit supprimée la vente de la force de travail, autrement dit le salariat.
Dans le premier livre du Capital, nous nous trouvons sans cesse sur le lieu même du travail ; dans une fabrique, dans une mine ou dans une exploitation agricole moderne. Ce qui y est exposé vaut pour n'importe quelle entreprise capitaliste. Nous avons uniquement affaire au capital individuel en tant que type de tout le mode de production.
Quand nous fermons ce premier livre, la naissance quotidienne du profit est pour nous parfaitement claire, le mécanisme de l'exploitation élucidé jusque dans ses derniers recoins. Sous nos yeux s'élèvent des montagnes de marchandises de toutes sortes, telles qu'elles sortent directement de l'atelier, encore imbibées de sueur ouvrière; et, dans la valeur de chacune d'elles, nous pouvons nettement discerner la partie issue du travail non payé du prolétaire et qui devient tout aussi légitimement que la marchandise entière, propriété du capitaliste. Nous touchons ici du doigt la racine de l'exploitation.
Mais la moisson du capitaliste est encore loin pour cela d'être engrangée. Le fruit de l'exploitation est là, mais sous uue forme encore inutilisable pour le patron. Tant qu'il ne possède ce fruit que sous les dehors de marchandises accumulées, le capitaliste ne peut s'estimer satisfait de l'exploitation. C'est que précisément il n'est pas le propriétaire d'esclaves du monde gréco-romain de l'antiquité, non plus que le seigneur féodal du moyen âge, qui ne dépouillaient le peuple travailleur que pour leur propre luxe et la grande vie de cour.
Le capitaliste a besoin de sa richesse en monnaie sonnante pour l'employer à entretenir le « train de vie de sa condition» et pour accroître sans répit son capital. Il faut, à cet effet, que soient vendues les marchandises produites par l'ouvrier salarié, y compris la plus-value contenue en elles. Du dépôt de fabrique ou de la ferme, la marchandise doit accéder au marché; le capitaliste la suit du comptoir à la Bourse, au magasin, et nous marchons sur ses traces dans le deuxième livre du Capital.
Dans le domaine de l'échange des marchandises, où se déroule le deuxième chapitre de l'existence du capitaliste, maintes difficultés attendent ce dernier. Dans sa fabrique, à la ferme, il était le maître L'organisation la plus stricte, la discipline et l'ordre y régnaient. Sur le marché, par contre, règne l'anarchie complète, ce qu'on appelle la libre-concur-rence. Ici, nul ne se soucie du voisin et personne de l'ensemble. Et pourtant, an milieu même de cette anarchie, le capitaliste sent combien il dépend à tous égards des autres, de la société.
Il doit marcher du même pas que ses concurrents. S'il perd plus de temps qu'il est strictement nécessaire avant la vente définitive de ses marchandises, s'il ne se munit pas d'assez d'argent pour acheter à temps des matières premières et tout ce qui est nécessaire pour que l'entreprise ne subisse aucun temps d'arrêt, s'il ne veille pas à ce que son argent, tel qu'il lui revient de la vente des marchandises, ne reste pas inactif, mais soit investi quelque part d'une façon rémunératrice, il est éclipsé d'une manière ou d'une autre. Or, les chiens mordent les derniers et le patron isolé qui ne fait pas en sorte que, dans le va-et-vient continuel entre la fabrique et le marché, son affaire marche aussi parfaitement que la fabrique même, ce patron donc, aussi consciencieusement qu'il utilise ses ouvriers, n'obtiendra pas le profit usuel. Une partie de son profit «bien acquis» restera accrochée quelque part, pas dans sa poche en tout cas.
Mais ce n'est pas tout. Le capitaliste ne peut accumuler des richesses que s'il produit des marchandises, donc des articles de consommation. Mais il ne doit produire précisément que les sortes de marchandises dont la société a besoin, et seulement autant qu'elle en a besoin. Sinon, les marchandises restent invendues et la plus-value qui s'y trouve enfermée s'en va à nouveau en fumée.
Mais comment un capitaliste isolé saurait-il tout cela? Personne ne lui dit de quels articles et, en quelle quantité la société a besoin à un moment donné; personne ne le lui dit parce que, précisément, personne ne le sait. Ne vivons-nous pas dans une société sans plan, anarchique? Chacun des patrons pris séparément est dans la même situation. Et pourtant, il doit sortir de ce chaos, de ce désordre un tout qui permette aussi bien l'affaire individuelle des capitalistes et leur enrichissement que la satisfaction des besoins de la société et la continuation de la société prise dans son ensemble.
Plus précisément, il faut que le désarroi du marché déréglé permette néanmoins, en premier lieu, le cycle permanent du capital individuel, donne la possibilité de produire, de vendre, d'acheter et à nouveau de produire, le capital muant sans cesse de sa forme argent à sa forme marchandise et inversement: ces phases doivent coïncider, l'argent doit exister en réserve, afin de saisir toute conjoncture d'achat sur le marché, afin de couvrir les dépenses courantes de l'entreprise : par ailleurs, il faut que l'argent - qui revient au fur et à mesure de la vente des marchandises – trouve aussitôt à s'employer à nouveau. Les capitalistes isolés, en apparence complètement indépendants les uns des autres, forment ici déjà une grande confrérie; en fait, au moyen du crédit et des banques, ils s'avancent continuellement les uns aux autres l'argent nécessaire et puisent dans l'argent en réserve, permettant ainsi la continuation ininterrompue de la production et de la vente des marchandises pour l'individu comme pour la société. Le crédit, que l'économie politique bourgeoise ne peut expliquer autrement que comme une habile institution destinée à «faciliter la circulation des marchandises», Marx, dans le deuxième livre de son oeuvre, montre, tout à fait en passant, qu'il n'est qu'un simple mode d'existence du capital, un lien entre les deux phases de la vie du capital: dans la production et sur le marché, ainsi qu'entre les mouvements en apparence autonomes des divers capitaux.
En second lieu, il faut que dans la confusion des capitaux isolés soit maintenu le cycle permanent de la production et de la consommation de la société dans son ensemble, et cela de telle façon que demeurent assurées les conditions de la production capitaliste:
fabrication des moyens de production, ravitaillement de la classe ouvrière, enrichisse-ment progressif de la' classe capitaliste, c'est-à-dire accumulation, et activité croissante du capital global de la société. La façon dont l'ensemble résulte des innombrables mouvements indépendants des capitaux isolés, dont ce mouvement de l'ensemble est toujours ramené au juste rapport par les variations continues tantôt dans la surabondance de la haute conjoncture, tantôt dans l'effondrement de la crise, pour s'en échapper à nouveau l'instant d'après, la façon dont ce qui n'est aujourd'hui qu'un moyen dans la société- sa propre subsistance et le progrès économique-et ce qui est son but-l'accumulation continue des capitaux - découle de tout ce qui précède en prenant des proportions de plus en plus formidables, tout cela, Marx ne l'a sans doute pas définiti-vement résolu dans le deuxième livre de son oeuvre, mais il l'a placé pour la première fois depuis cent ans, depuis Adam Smith, sur les bases sérieuses de la loi scientifique.
Mais la tâche épineuse du capitaliste n'est pas encore épuisée avec tout ce que nous avons déjà vu. Une fois le profit transformé dans une mesure croissante en or, et au cours même de cette transformation, une grande question se pose en effet: celle du partage du butin. Des groupes fort divers formulent leurs prétentions : à côté de l'industriel se présentent le marchand, le bailleur de fonds, le propriétaire foncier. Tous ont permis à leur manière l'exploitation de l'ouvrier salarié et la vente des marchandises produites par lui, et tous réclament maintenant leur part au profit; Mais cette répartition est une tâche beaucoup plus complexe qu'il peut paraître au premier abord. Car parmi les industriels, il existe également selon la nature de l'entreprise, de grandes différences, dans le profit réalisé, tel qu'il est pour ainsi dire puisé sur le lieu de travail.
Dans telle branche de production, la fabrication de marchandises et leur vente sont très rapidement expédiées et le capital revient, accru, dans le temps le plus bref; il permet d'aller bon train dans les affaires et le profit. Dans les autres branches, le capital est solidement fixé pendant des années dans la production et ne rapporte de profit qu'au bout d'un temps fort long. Dans certaines branches, le patron doit investir la majeure partie de son capital dans des moyens de production morts: bâtiment, machines coûteuses, etc., qui ne rapportent rien par eux-mêmes, ne fournissent aucun profit, pour autant indispensables qu'ils soient à l'obtention du profit. Dans d'autres branches encore, avec un outillage très réduit, le patron peut employer la majeure partie de son argent au recrutement d'ouvriers dont chacun est une poule diligente qui pond pour lui des oeufs d'or.
C'est ainsi qu'apparaissent dans l'obtention même du profit de grandes différences entre les divers capitaux, différences qui constituent à la face de la société bourgeoise une «injustice» beaucoup plus criante que le « singulier » partage entre le capitaliste et l'ouvrier. Comment parvenir ici à un équilibre, comment partager « équitablement » le butin, de telle sorte que chaque capitaliste reçoive «son dû» ? De plus, tous ces problèmes doivent être résolus sans aucune règlementation consciente et systématique. La répartition est, en effet, aussi anarchique que la production dans la société actuelle.
C'est qu'il n'y a pas de « répartition » véritable dans le sens d'une quelconque mesure d'ordre social il y a exclusivement échange, circulation des marchandises, vente et achat. Comment, dès lors, chaque catégorie d'exploiteurs et chaque exploiteur pris isolément obtiennent-ils par le seul canal de l'échange aveugle des marchandises une portion «équitable » - équitable du point de vue de la domination capitaliste - des richesses tirées de la force de travail du prolétariat ?
Dans son troisième livre, Marx répond à ces questions. De même que dans le premier livre il a démembré la production au capital et révélé le secret du profit, de même qu'il a dépeint dans le deuxième livre le mouvement du capital entre la fabrique et le marché, entre la production et la consommation de la société, de même, il suit pas à pas dans le troisième livre la répartition du profit.
Et toujours en observant les trois conditions fondamentales ; tout ce qui se passe dans la société capitaliste n'est pas arbitraire, mais répond à des lois déterminées, agissant régulièrement, bien qu'absolument inconscientes pour les intéressés ; en second lieu, les rapports sociaux ne reposent pas sur des mesures violentes de vol et de brigandage ; et, enfin, aucune sagesse sociale n'apparaît pour agir systématiquement sur l'ensemble. C'est uniquement à partir du mécanisme de l'échange, c'est-à-dire de la loi de la valeur et de la plus-value qui en découle, que Marx développe progressivement, avec une clarté et avec une logique pénétrantes, tous lés phénomènes et rapports de l'économie capitaliste.
Si l'on considère l'oeuvre dans son ensemble, on peut dire : Le premier livre, avec ses développements sur la loi de la valeur, le salaire et la plus-value, met à nu les bases de la société actuelle ; le deuxième et le troisième livres montrent les étages de l'édifice construit sur ces fondations. On pourrait encore dire, en se servant d'une tout autre image le premier livre nous montre le coeur de l'organisme social; où est produit le sang vivifiant ; le deuxième et le troisième montrent la circulation du sang et la nutrition de l'ensemble jusque dans les dernières -cellules de la peau.
En ce qui concerne le contenu, nous nous mouvons, dans les deux derniers livres, sur un plan tout différent du premier. Dans celui-ci nous découvrions la source de l'enrichissement capitaliste à la fabrique, dans les profondes assises sociales du travail. Dans les deuxième et troisième livres, nous sommes à la surface, sur la scène officielle de la société. Magasins, banques, Bourses, affaires financières, « agrariens nécessiteux » et leurs soucis occupent ici le premier plan. L'ouvrier n'entre plus en ligne de compte. Dans la réalité, il ne s'occupe d'ailleurs pas de ces choses, qui se passent derrière son dos, alors qu'il a déjà été écorché. Et dans la cohue bruyante de la foule affairée, nous ne rencontrons en fait les ouvriers qu'à l'aube, quand ils gagnent en troupes les usines, et au crépuscule, lorsque leurs ateliers les rejettent à nouveau en longues théories.
On peut, à cet égard, ne pas apercevoir l'intérêt que peuvent présenter pour les ouvriers les divers soucis privés des capitalistes dans la course au profit et leurs querelles pour le partage du butin. Mais, en fait, les deuxième et troisième livres du Capital contribuent autant que le premier à la connaissance définitive du mécanisme social contemporain. Il est vrai qu'ils ne revêtent pas pour le mouvement ouvrier moderne l'importance historique, décisive et fondamentale, du premier. Mais ils contiennent une foule de considérations qui sont également d'une valeur inestimable pour l'armement spirituel du prolétariat en vue de la lutte pratique. En voici deux exemples seulement.
Dans le deuxième livre, en traitant de la façon dont la nutrition régulière de la société peut résulter de l'action chaotique des capitaux isolés, Marx en vient naturellement à parler des crises. On ne peut s'attendre ici à une étude systématique et magistrale des crises, mais seulement à des remarques incidentes. Cependant, l'utilisation de ces remarques serait d'un grand profit pour les ouvriers éclairés et pensants. C'est un argu-ment qui a pris droit de cité dans l'agitation social-démocrate, et notamment syndicale, que « les crises résultent avant tout de l'étroitesse de vues des capitalistes : ces derniers ne veulent malheureusement pas comprendre que les masses de leurs ouvriers sont leurs principaux clients et qu'il suffirait seulement de leur payer des salaires plus élevés pour conserver une clientèle solvable et conjurer le danger de crise ».
Si populaire qu'elle soit, cette conception des choses n'en est pas moins diamétralement contraire à la réalité et Marx la réfute dans les termes suivants :
C'est une pure tautologie de dire que les crises découlent du défaut de consommation payante ou de consommateurs capables de payer. Le système capitaliste ignore le consommateur autrement que payant, sauf sous la forme de la charité ou de la a «grivèlerie». Le fait que des marchandises soient invendables signifie tout simplement qu'il ne s'est pas trouvé pour elles d'acheteurs capables de payer, donc de consommateurs. Mais si l'on veut donner à cette tautologie un semblant de preuve plus profonde en disant que la classe ouvrière - ne reçoit qu'une partie trop faible de son propre produit et que le mal serait conjuré du moment qu'elle en recevrait une partie, plus grande, du moment donc que son salaire augmenterait, il suffit alors de remarquer que les crises sont toujours précédées par une période où le salaire augmente d'une façon générale, où la classe ouvrière reçoit une part relativement plus grande du produit annuel destiné à la consommation. Du point de vue de ces chevaliers du sain et «simple » bon sens, cette période devrait, au contraire, éloigner la crise. Il semble donc que la production capitaliste implique des conditions - indépendantes de le bonne ou de la mauvaise volonté - qui ne permettent que momentanément cette prospérité relative de la classe ouvrière, et toujours comme signe avant-coureur d'une crise117.
En fait, les explications du deuxième livre comme du troisième donnent une vue profonde de la nature des crises; celles-ci apparaissent tout simplement comme des conséquences inévitables du mouvement du capital, un mouvement qui, dans son élan impétueux vers l'accumulation, vers l'accroissement, franchit toutes les barrières de la consommation, même si cette consommation est étendue autant qu'on veut par l'augmentation du pouvoir d'achat d'une catégorie sociale ou par la conquête de débouchés tout à fait nouveaux. Il faut donc aussi abandonner l'idée de l'harmonie des intérêts entre le capital et le travail, méconnue seulement par la myopie du patronat, idée qui se dessine au fond de cette agitation syndicale populaire; il faut aussi renoncer a tout espoir d'un raccommodage susceptible d'amoindrir l'anarchie capitaliste. La lutte pour l'élévation matérielle du prolétaire salarié possède dans son arsenal spirituel mille armes par trop acérées pour avoir besoin de cet argument théoriquement sans valeur et pratiquement douteux.
Autre exemple. Dans le troisième livre, Marx donne, pour la première fois, une explication scientifique d'un fait que l'économie politique considère bouche bée depuis qu'elle existe: dans toutes les branches de production, et bien qu'investie dans les conditions les plus différentes, les capitaux ont coutume de produire le profit dit «courant». A première vue, ce phénomène semble contredire une explication donnée par Marx lui-même, à savoir l'explication de la richesse capitaliste uniquement par le travail non payé du prolétariat salarié. Comment, en fait, le capitaliste obligé d'investir des parties relativement considérables de son capital dans des moyens de production morts peut-il obtenir le même profit que son collègue, qui n'a que peu de dépenses de cet ordre et qui peut, par conséquent, employer une quantité plus grande de travail vivant?
Or, Marx résout l'énigme avec une simplicité surprenante en montrant comment les différences de profits s'équilibrent par la vente d'une marchandise au-dessus de sa valeur, par la vente de l'autre au-dessous, et comment se réalise de la sorte un «profit moyen» identique pour toutes les branches de la production. Sans s'en douter, sans aucun accord délibéré entre eux, les capitalistes procèdent dans l'échange de leurs marchandises de telle sorte que chacun d'eux apporte au tas commun la plus-value tirée de ses ouvriers et que tous ensemble se partagent fraternellement cette moisson générale de l'exploitation, donnant à chacun selon l'importance de son capital. Le capitaliste individuel ne bénéficie donc pas du profit obtenu personnellement par lui, mais seulement d'une partie -celle qui lui revient- des profits réalisés par tous ses compagnons.
Dans la mesure où il s'agit du profit, les divers capitalistes se comportent ici comme de simples actionnaires d'une société anonyme où les parts au profit sont uniformément distribuées en pourcent et ne diffèrent, par conséquent, pour les divers capitalistes que selon la grandeur du capital placé par chacun d'eux dans l'entreprise commune, après sa participation relative à l'entreprise globale.
Combien cette loi en apparence tout à fait sèche des «taux de profit moyen» nous permet, de pénétrer profondément dans la solide base matérielle de la solidarité de classe des capitalistes qui, frères ennemis dans l'agitation quotidienne, n'en constituent pas moins contre la classe ouvrière une franc-maçonnerie hautement et personnellement intéressée à son exploitation globale !
Sans que les capitalistes se rendent naturellement compte de ces lois objectives, leur instinct infailliblé de classe dominante révèle une perception de leurs propres intérêts de classe et de leur antagonisme à l'égard du prolétariat, instinct qui s'affirme malheureusement beaucoup plus sûrement à travers tous les orages de l'histoire que la
117 Marx : le Capital, t. Xlll, p. 19. Edit. Costes. 81
conscience de classe des ouvriers, éclairée et fondée justement par les oeuvres de Marx et d'Engels.
Puissent ces deux brèves illustrations, prises au hasard, donner une idée des trésors intacts qui s'offrent encore au prolétariat éclairé dans les deux derniers livres du Capital, trésors de stimulation à la recherche et à l'étude, qui attendent encore un exposé populaire.
Inachevés, tels qu'ils sont, ils offrent quelque chose d'infiniment plus précieux que toute vérité achevée: l'incitation à la pensée, à la critique et à l’autocritique, qui constitue l'élément le plus original de la doctrine laissée par Marx.
Rosa Luxembourg
FRANZ MEHRING : « LE CAPITAL »..........................................................................................................65
I. LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT...............................................................................................................65
II. LE PREMIER LIVRE........................................................................................................................................67
ROSA LUXEMBOURG :..................................................................................................................................76
III. LES DEUXIEME ET TROISIEME LIVRES...........................................................................................................76
NOTE DES EDITEURS


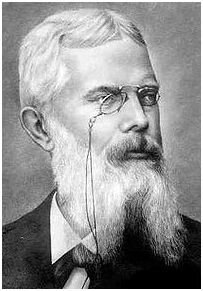



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F73%2F387740%2F133085892_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F68%2F387740%2F131925516_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F37%2F387740%2F133979911_o.png)
/image%2F1357365%2F20240315%2Fob_084460_classetravail.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F63%2F387740%2F134101697_o.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F95%2F387740%2F132628064_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F49%2F387740%2F45925640_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F29%2F10%2F387740%2F45925500_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F3%2F333492.jpg)